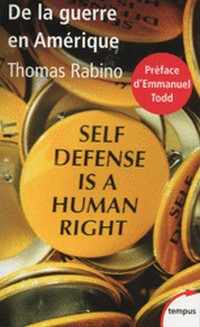Nous reproduisons ci-dessous entretien avec Alain de Benoist, cueilli sur Boulevard Voltaire, dans lequel il évoque la famille... Philosophe et essayiste, Alain de Benoist a récemment publié Le moment populiste (Pierre-Guillaume de Roux, 2017), Ce que penser veut dire (Rocher, 2017) et L'écriture runique et les origines de l'écriture (Yoran, 2017).

Alain de Benoist : « La famille est certes une valeur-refuge. Mais de quelles familles parlons-nous ? »
Pour la droite catholique et l’ensemble de la mouvance conservatrice, la famille n’a jamais été aussi menacée. Pourtant, ceux que l’on désigne comme ses ennemis n’ont, eux-mêmes, que le mot de « famille » à la bouche. Comment s’y reconnaître ?
Tous les sondages montrent, en effet, que la famille reste, dans l’opinion, la valeur la plus sûre, on pourrait dire la valeur-refuge par excellence. Mais c’est vrai, aussi, qu’elle est constamment menacée et attaquée. C’est que, dans les deux cas, on ne parle pas de la même chose. Pour la plupart de nos contemporains, la famille est une sorte de cocon assez égalitaire où se rencontrent avant tout les sentiments affectifs du moment. Pour les défenseurs de la « famille traditionnelle », la famille s’inscrit avant tout dans la durée. C’est une structure hiérarchisée, qui renvoie à l’enchaînement des générations et vis-à-vis de laquelle on a un certain nombre de devoirs. Malgré la résonance carcérale du terme, la famille se définit alors comme la « cellule de base » de la société. Mais c’est précisément ce qu’elle a cessé d’être.
Dans les pays occidentaux, l’époque actuelle a vu la fin de la civilisation patriarcale, qui est allée de pair avec la disparition de sociétés organisées principalement autour de l’impératif de reproduction et de l’autorité du « chef de famille » (aujourd’hui officiellement supprimée). Quatre autres faits concomitants sont également à prendre en compte : la déconsidération des valeurs « viriles », à commencer par celles du guerrier ou du citoyen-soldat, au profit d’une symbolique féminine-maternelle ; la désexualisation de la procréation, qui est désormais affaire de relations marchandes et de techniques assistées ; la « sentimentalisation », la privatisation et la désinstitutionnalisation du mariage et de la famille, à laquelle il n’est « plus rien demandé du point de vue de la formation du lien de société » (Marcel Gauchet) ; enfin, la consécration du « couple » défini comme une simple association contractuelle entre deux individus égaux en droit qui, en tant qu’association privée, n’exerce elle non plus aucune fonction sociale.
Le concept de « famille » n’a-t-il pas évolué au fil des siècles ? Et aujourd’hui, est-il forcément le même selon les cultures et les latitudes ?
La famille est un invariant, mais ses formes sont innombrables. Ce que beaucoup appellent la « famille traditionnelle », le trio papa-maman-enfant(s), est en réalité d’apparition tardive. La vraie société traditionnelle ne conçoit que la famille élargie, souvent jusqu’aux dimensions du clan. À partir d’une typologie rigoureuse des relations de parenté, de la tendance plus ou moins forte à l’endogamie, des normes relatives au choix du conjoint ou au partage de l’héritage, Emmanuel Todd, dont les travaux s’inscrivent dans la ligne de Frédéric Le Play, distingue plusieurs types de structures familiales, qu’il met ensuite en rapport avec les grandes tendances politico-sociales que l’on observe dans la société : la famille nucléaire absolue (libérale et indifférente à l’égalité), la famille nucléaire égalitaire (libérale et égalitaire), la famille souche (autoritaire et inégalitaire) et la famille communautaire (autoritaire et égalitaire). En France, la famille nucléaire égalitaire domine dans la partie nord. La famille souche, restée forte dans le Midi, se retrouve dans beaucoup de pays du tiers-monde, notamment le Maghreb et le Proche-Orient.
On a souvent l’impression que beaucoup confondent les notions d’« amour » et de « famille ». Comme s’il suffisait de s’aimer pour constituer une famille, alors qu’il existe aussi des familles sans amour, parfois plus solides que d’autres. Y a-t-il là confusion des genres, si l’on peut dire en la circonstance ?
Ah, l’amour ! « L’infini à la portée des caniches », disait Céline. « L’Hamour avec un grand H » dont se moquait Flaubert. Mais de de quoi parle-t-on ? D’éros, de philia ou d’agapè ? De l’amour pour une ou des personnes concrètes, ou de l’amour de tous, c’est-à-dire de personne ? Il est bien entendu préférable, sinon nécessaire, qu’il y ait de l’amour au sein des familles et au sein des couples. Mais cela ne suffit certainement pas à y faire régner l’harmonie. Concernant le mariage, tout dépend aussi de quelle manière on le considère : comme un contrat entre deux individus ou comme une alliance entre deux lignées. Au Moyen Âge, l’amour courtois est essentiellement dirigé contre l’institution du mariage. Dans la conception moderne des choses, où le mariage n’est qu’un contrat entre deux personnes qui s’attirent mutuellement, l’amour est évidemment l’élément-clé. Mais c’est aussi ce qui le rend fragile : on se marie parce qu’on s’aime, on se démarie parce qu’on ne s’aime plus. Il ne faut pas se le dissimuler : le mariage d’amour, qui privilégie l’intensité sur la durée, est aujourd’hui la première cause du divorce.
C’est aussi ce primat d’un « amour » mal défini qui est à l’origine de la confusion entre Vénus et Junon. Toute amante d’un homme marié rêve de prendre la place de sa femme, comme si leurs rôles étaient interchangeables. Vous connaissez peut-être ces mots que l’on attribue tantôt à Démosthène, tantôt à Apollodore, prononcés au IVe siècle avant notre ère devant les citoyens assemblés en tribunal : « Les courtisanes, nous les avons pour le plaisir ; les concubines, pour les soins de tous les jours ; les épouses, pour qu’elles nous donnent une descendance légitime et soient les gardiennes fidèles de notre foyer. » Je trouve qu’ils contiennent beaucoup de sagesse. Les Anciens savaient la différence qui existe entre Vénus et Junon.
Alain de Benoist, propos recueillis par Nicolas Gauthier (Boulevard Voltaire, 8 août 2018)